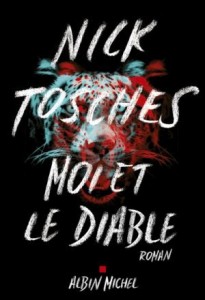 C’est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons Nick Tosches, son érudition fine, sa plume à la fois élitaire et dégingandée, ses analyses lucides – certains diront cyniques – et quelque peu misanthropes de la faune contemporaine… Son dernier né, Moi et le Diable, ne fait pas défaut…
C’est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons Nick Tosches, son érudition fine, sa plume à la fois élitaire et dégingandée, ses analyses lucides – certains diront cyniques – et quelque peu misanthropes de la faune contemporaine… Son dernier né, Moi et le Diable, ne fait pas défaut…
Nick Tosches est le héros de ce roman. Il se dépeint sous un jour assez fidèle à l’idée que nous nous faisions de lui : cultivé, buveur, amateur d’opium frustré de ne plus en trouver de bon (lisez ses Confessions d’un chasseur d’opium, publiées chez Allia en 2001, rééditées en 2004), et critique acerbe du monde actuel. Un mécontemporain, pour reprendre le terme imaginé par Alain Finkielkraut à propos de Charles Péguy, qui ne manque ni de lucidité ni d’humour sur la société libérale-libertaire hygiéniste et moralinisante que les États-Unis exportent avec un certain succès, soyons beau joueur, à travers le monde en général, et l’Occident européen en particulier. Ainsi quand il décrit les « soumis » qui se hâtent de prendre leur taxi à l’heure où le métro est plus rapide :
« C’est une drôle d’engeance, ces esclaves blancs aux ignobles carrières d’indolence lucrative. Dire qu’ils méritent la mort reviendrait à dénigrer la mort. Et ce serait absurde, de plus, car en un sens ils sont déjà morts. Des morts qui font du jogging. Des cadavres attentifs à leur taux de glucides avec des sourires figés pleins d’entrain faux et absurde sur leurs visages mornes bien récurés et soignés. »
Tosches, auteur, héros et narrateur du roman, apparait en contrepoint comme marginal. Marginal mais libre. Il n’a pas publié depuis un certain temps et hante les bars de Manhattan. C’est dans un de ces cafés qu’il rencontre Mélissa, point de départ d’un changement radical, d’un engrenage diabolique où le goût du sang le dispute à la perversion…
Le roman de Nick Tosches est émaillé de références littéraires, poétiques et musicales, sans qu’aucune forme de pédanterie ne transpire. Tosches est rock’n’roll, au sens vrai. Il a beaucoup écrit sur le sujet. Tosches est surtout un Écrivain, dans le sens où la Littérature est définie comme « la métamorphose d’une expérience individuelle en vérité universelle par le biais d’une écriture qui n’appartient qu’à son auteur » (Bruno de Cessole, entretien avec Matthieu Giroux, Philitt, 14 janvier 2016). Le style littéraire de Tosches lui appartient en propre. Pour une fois, le terme singulier n’est pas galvaudé.
Fidèle à lui-même, Nick Tosches ne peut s’empêcher d’adresser quelques piques bien senties aux Diafoirus, notamment à ceux qui se font appeler « addictologues » et qui ont tendance « à vouloir perpétuer l’addiction de leur patient plutôt que de le soigner ». Car comme le remarque justement Tosches, dans un système de santé capitaliste financiarisé, la « caisse enregistreuse » l’emporte toujours sur la question de vie ou de mort. Inutile de préciser que nous sommes d’accord.
Moi et le Diable est un grand roman, la tragédie d’un mécontemporain qui se refuse à être l’esclave de son temps, à l’inverse de ses contemporains qui se croient libres. Or, « un esclave qui se croit libre ne conçoit nulle échappatoire, car il ne conçoit pas de liberté au-delà de celle que lui autorise sa place dans la vie. Un esclave qui épouse les libertés de l’esclavage est un fort bon esclave, c’est certain ». Et c’est hélas la réalité des sociétés occidentales dites libres.
Philippe Rubempré
Nick Tosches, Moi et le Diable, traduit le l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié, 2015, 418 pages, 22,90 euros



