« J’écoute attentivement toutes ces discussions ; et vous deux, et d’autres personnes instruites dans la ville ; je lis des journaux et des revues. Et plus je vous écoute, plus je suis persuadé que la plupart de ces controverses orales ou écrites n’ont rien à voir avec la vie et ses exigences ou ses problèmes réels. Car la vie, la vraie vie, je l’observe de tout près, je la vois chez les autres et je m’y frotte personnellement chaque jour que Dieu fait. Il se peut que je me trompe, et je ne sais même pas m’exprimer comme il faut, mais il me vient souvent à l’idée que le progrès technique et la paix relative qui règne dans le monde ont permis une sorte de trêve, engendré une atmosphère particulière, artificielle et irréelle, dans laquelle une classe de gens, que l’on appelle les intellectuels, peut en toute liberté s’amuser de façon intéressante et agréable à jongler avec les idées et les « conceptions de la vie et du monde ». Une sorte de serre de l’esprit, avec un climat artificiel et une flore exotique, mais sans le moindre lien avec la terre, le sol réel mais dur que foule la masse des vivants. Vous croyez discuter du destin de ces masses et de la façon dont elles peuvent être utilisées dans la lutte pour atteindre de nobles objectifs que vous lui fixez, mais en fait, les mécanismes qui tournent dans vos têtes n’ont rien à voir avec la vie des masses, ni même avec la vie en général. C’est là que votre petit jeu devient dangereux, ou du moins peut le devenir pour les autres comme pour vous-mêmes. »
Ivo Andric, op. cit., pp.291-292.
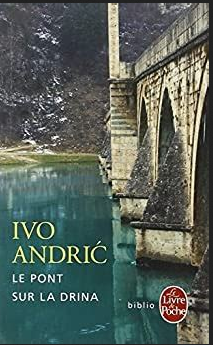
Le livre dont le héros est un pont. Ivo Andric, « serbe par son choix et sa résidence en dépit de son origine croate et de sa provenance catholique, bosniaque par sa naissance et son appartenance la plus intime, yougoslave à part entière tant par sa vision poétique que sa prise de position nationale » (Predrag Matvejevitch, Postface), prix Nobel de Littérature en 1961, révèle dans ce roman la symbolique lourde de ce pont en pierre sur la Drina, entre Orient et Occident, entre Bosnie et Serbie, à Visegrad, construit au XVIe siècle par un sultan originaire du lieu.
L’ Histoire avec un grand H s’ouvre à travers le prisme de ce pont et de sa partie centrale, la kapia, qui a connu les discussions, les miradors et les têtes coupées ; kapia carrefour des populations musulmanes, juives et chrétiennes, sous domination ottomane puis austro-hongroise. Situé au cœur de la « poudrière des Balkans », le pont sur la Drina est le témoin incontestable de la réalité d’une société multiculturelle (par essence multi-conflictuelle), de sa construction à partir de 1516 jusqu’à l’explosion de 1914, après l’assassinat par Gavrilo Princip, jeune nationaliste serbe, de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, et de son épouse ; explosion dont nous connaissons les effroyables conséquences, et qui, à Visegrad et ailleurs, se traduisit ainsi :
« La bête affamée qui vit en l’homme mais ne peut se manifester tant que subsistent les obstacles des bons usages et de la loi était maintenant lâchée. […] Comme cela arrive souvent dans l’histoire, la violence et le vol, et même le meurtre, étaient tacitement autorisés, à condition qu’ils fussent pratiqués au nom des intérêts supérieurs, sous le couvert de mots d’ordre, à l’encontre d’un nombre précis de personnes aux noms et aux convictions bien définis. » (p. 331).
Le Pont sur la Drina est un excellent roman qui invite à la réflexion et à la modestie quant au sens de l’histoire – forcément multiculturel et métissé – que nous imposent nos « élites » politiques depuis quelques décennies, cette anglo-saxonnisation de la France (et de l’Europe) à marche forcée, qui se mue, pas si doucement que cela, mais sûrement, en balkanisation (ou en libanisation, si vous préférez son double levantin).
La Babel libérale-libertaire pacifiée et tolérante dont rêve une grande partie de la caste dirigeante est une chimère infernale. Or, nous le savons, l’enfer, c’est les autres et c’est pavé de bonnes intentions.
Philippe Rubempré
Ivo Andric, Le Pont sur la Drina, postface de Predrag Matvejevitch, trad. (serbo-croate) Pascale Delpech, [Belfond, 1994] Le Livre de Poche Biblio, édition 20, juin 2022, 381 p.



