Le Bocage à la nage – Olivier Maulin
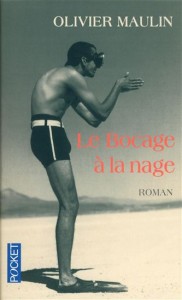 « Las, comme dit Péguy (et Berthelot dans ses bons jours), l’époque est venue de ceux qui font le malin. De ceux qui considèrent qu’être né en dernier est un gage de supériorité. De ceux qui regardent le passé avec un petit sourire paternaliste. « Si l’on supprimait les haies, on gagnerait en surface agricole », pensèrent les malins en clignant de l’oeil. Il y eut les remembrements intensifs, la destruction des haies subventionnée par l’État, le comblement des mares, l’assassinat des grenouilles rieuses et des tritons crêtés, l’agrandissement des parcelles et la monoculture : là où l’on cultivait dix espèces, il n’en resta plus qu’une qu’il fallut inonder de pesticides pour éviter les maladies que toute culture unique appelle. Le résultat ne se fit pas attendre : ruissellement, érosion, inondations, cours d’eau pollués, disparition des poissons, appauvrissement des nappes phréatiques, assèchement des zones humides, disparition des oiseaux, prolifération des vers et des insectes nuisibles, utilisation de la chimie, là encore, pour s’en débarrasser. Quinze millions d’hectares remembrés. Un million cinq cent mille kilomètres de haies arrachées (sur deux millions !). Des destructions irréversibles. L’équilibre écologique ancestral brisé à tout jamais. Du vandalisme vendu sous le nom de progrès. De la bêtise crasse et orgueilleuse.«
« Las, comme dit Péguy (et Berthelot dans ses bons jours), l’époque est venue de ceux qui font le malin. De ceux qui considèrent qu’être né en dernier est un gage de supériorité. De ceux qui regardent le passé avec un petit sourire paternaliste. « Si l’on supprimait les haies, on gagnerait en surface agricole », pensèrent les malins en clignant de l’oeil. Il y eut les remembrements intensifs, la destruction des haies subventionnée par l’État, le comblement des mares, l’assassinat des grenouilles rieuses et des tritons crêtés, l’agrandissement des parcelles et la monoculture : là où l’on cultivait dix espèces, il n’en resta plus qu’une qu’il fallut inonder de pesticides pour éviter les maladies que toute culture unique appelle. Le résultat ne se fit pas attendre : ruissellement, érosion, inondations, cours d’eau pollués, disparition des poissons, appauvrissement des nappes phréatiques, assèchement des zones humides, disparition des oiseaux, prolifération des vers et des insectes nuisibles, utilisation de la chimie, là encore, pour s’en débarrasser. Quinze millions d’hectares remembrés. Un million cinq cent mille kilomètres de haies arrachées (sur deux millions !). Des destructions irréversibles. L’équilibre écologique ancestral brisé à tout jamais. Du vandalisme vendu sous le nom de progrès. De la bêtise crasse et orgueilleuse.«
***
Qu’Olivier Maulin et son éditeur me pardonnent une si longue citation, mais ce texte est tellement criant de vérité, de sincérité, de beauté perdue, d’amour de la nature sacrifiée sur l’autel du soit-disant progrès et du Saint-Fric mondialisé… Maulin a composé Le Bocage à la nage après une résidence en Mayenne, terre de bocage, à l’invitation de l’association Lecture en Tête. Son bocage est mayennais, la nage est à contre-courant du monde comme il va (ou plutôt, comme il ne va pas).
Doué d’un humour féroce accompagné d’un sens de la répartie et du dialogue que d’aucun compare à Michel Audiard (respect !), Olivier Maulin entreprend de nous conter l’histoire de Berthelot, commercial raté s’esquintant à ne pas vendre ses monte-escaliers électriques aux petits vieux sensés, selon celui qu’il a délicatement affublé du sobriquet de Boule de merde, pulluler en Mayenne et être un potentiel de rentabilité exceptionnel. Son parcours croise une jungle de marginaux fantastiques dont certains noms laissent rêveur : Pote Jésus, Cro-Magnon… et un hoberau perché, sis au manoir du Haut-Plessis, qui a fait de son domaine leur royaume. Tout se gâte quand concomitamment Berthelot se fait virer, recueille avec Cro-Magnon une gamine battue par son beau-père, et que, par des circonstances que je vous laisse découvrir, les services secrets s’en mêlent…
Olivier Maulin est un écrivain à rapprocher de Gérard Oberlé, de Jean-Claude Pirotte ou de René Fallet. Une plume franche, singulière, drôle, au service d’une intrigue déjantée célébrant la nature, l’honneur, le savoir-vivre tant gastronomique qu’éthylique, bref tout ce que notre monde libéral-libertaire hygiéno-culpabilisant s’attache consciencieusement à faire disparaitre au profit de l’interchangeable, de l’indifférenciation, et surtout du Saint-Fric sonnant et trébuchant. Résistez ! Lisez Maulin !
Philippe Rubempré
Olivier Maulin, Le Bocage à la nage, (Balland, 2013) Pocket, 2015, 237 p.
Ab hinc… 210
« L’homme est né pour le plaisir : il le sent, il n’en faut point d’autre preuve. Il suit donc sa raison en se donnant au plaisir. » – Pascal
Lectures avril
- Les Tuniques Bleues – Les Bleus tournent cosaques – Lambil & Cauvin
- Les Tuniques Bleues – Black Face – Lambil & Cauvin
- Les Tuniques Bleues – Qui veut la peau du Général ? – Lambil & Cauvin
- Le Livre de la Jungle – Rudyard Kipling
- Les Tuniques Bleues – Requiem pour un Bleu – Lambil & Cauvin
- Les Tuniques Bleues – Stark sous toutes les coutures – Lambil & Cauvin
- Les Tuniques Bleues – Dent pour dent – Lambil & Cauvin
- Les Tuniques Bleues – Colorado Story – Lambil & Cauvin
- Journal et autres carnets inédits – Georges Brassens
- Un bon jour pour mourir – Jim Harrison
- Buck Danny contre Lady X – Hubinon & Charlier
- Meurtres à Canton – Robert Van Gulik
- Un taxi mauve – Michel Déon
- La liberté comme illusion – Vauvenargues
- Les Technopères 1 : La Pré-école Techno – Jodorowsky, Janjetov, Beltran
- Les secrets de la Mer Noire – Berghèse & de Bouhet
- Zone « Z » – Henri Vernes
- À nos amis – Comité invisible
- La… sottise ? (Vingt-huit siècles qu’on en parle) – Lucien Jerphagnon
- Absent de Bagdad – Jean-Claude Pirotte
- Le choc des incultures – Francis Balle
- Jamais deux sans trois – Gil Perrault
- L’érotisme français – Piero Lorenzoni
- Le cornet à dés – Max Jacob
- Adieu mademoiselle. La défaite des femmes – Eugénie Bastié
Ab hinc… 209
« Jamais l’humanité n’a réuni tant de puissance à tant de désarroi, tant de soucis et tant de jouets, tant de connaissances et tant d’incertitudes. L’inquiétude et la futilité se partagent nos jours. » – Paul Valéry
Ab hinc… 208
« Toute la duplicité de l’art contemporain est là : revendiquer la nullité, l’insignifiance, le non-sens, viser la nullité alors qu’on est déjà nul. Viser le non-sens alors qu’on est déjà insignifiant. Prétendre à la superficialité en des termes superficiels. » – Jean Baudrillard



