Comédie sentimentale pornographique – Jimmy Beaulieu
 L’excellente collection Shampooing propose avec cette Comédie sentimentale pornographique un roman graphique qui porte bien son titre. Corrine (sic) et Louis se sont rencontrés sur un coup de culot féminin dans la file d’attente d’un auteur en dédicace, Martin Gariépy. Croisant habilement les extraits du roman de Gariépy, sa loose sentimentale, la relation entre Corrine et Louis, et les souvenirs érotiques des personnages, Jimmy Beaulieu construit une comédie sentimentale drôle et inventive, ce qui n’est pas évident sur l’éternel sujet des relations amoureuses.
L’excellente collection Shampooing propose avec cette Comédie sentimentale pornographique un roman graphique qui porte bien son titre. Corrine (sic) et Louis se sont rencontrés sur un coup de culot féminin dans la file d’attente d’un auteur en dédicace, Martin Gariépy. Croisant habilement les extraits du roman de Gariépy, sa loose sentimentale, la relation entre Corrine et Louis, et les souvenirs érotiques des personnages, Jimmy Beaulieu construit une comédie sentimentale drôle et inventive, ce qui n’est pas évident sur l’éternel sujet des relations amoureuses.
Il est très difficile de résumer cette comédie chorale, d’en faire le « pitch » comme on dit en bon français. Toute l’histoire tourne autour de Louis et Corrine, et de leurs relations. Menant une vie libérée à Québec, Louis annonce à Corrine qu’il vient d’acheter sur un coup de tête un vieil hôtel sur la Côte-Nord. Ils décident d’y passer l’été avec un couple d’amis…
Comédie sentimentale pornographique est un roman graphique et très cinématographique, qui n’est pas sans rappeler certains films de potes, comme Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poirée, ou de vacances, La nouvelle tribu, feuilleton télé de Roger Vadim. Le tout entrecoupé de souvenirs et de scènes érotiques explicites, sans toutefois verser dans la vulgarité. Beaulieu a l’intelligence de les traiter avec humour et souvent de manière décalée. Comédie sentimentale pornographique sans prise de tête, lecture avec le sourire, érotisme cru, souvent drôle, jamais gratuit… On verrait bien ce roman dessiné devenir un film, par exemple des frères Farrelly ou mieux encore, des frères Coen.
En bref, une belle lecture en perspective, du genre à remettre du baume au coeur en ces tristes temps…
Philippe Rubempré
Jimmy Beaulieu, Comédie sentimentale pornographique, Delcourt, coll. Shampooing, 2011, 286 pages.
Ab hinc… 200
« Si je ne peux pas fumer de cigares au Ciel, je ne veux pas y aller ! » – Mark Twain
Ab hinc… 199
« – Elle était meilleure que moi, ce n’est pas une raison pour me mépriser.
Ces gens qui ne savent que mépriser, à quoi cela sert-il ? Le mépris est le masque des faibles.
Un homme fort ne méprise rien. Il a usage de tout. »
Paul Claudel, Le Pain dur, I;3
Cap Horn – Francisco Coloane
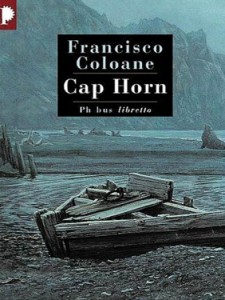 Cap Horn, Magellanie, Araucanie, Patagonie, Ushuaïa, ces territoires des sud chilien et argentin ont le parfum de l’aventure. Chez Coloane, l’écriture sent le mâle, le mouton, le chien, les embruns, le sang. Cap Horn est un recueil d’une quinzaine de courtes nouvelles taillées à la serpe, mettant l’Homme dans sa fragilité face à la nature et aux éléments tous puissants en cette pointe sud du continent américain. Des histoires d’hommes, écrites à la pointe de l’Eskilstuna, le couteau de ces gauchos de la Tierra del Fuego et des pêcheurs de Punta Arenas bravant la furie du cap Horn et des côtes de Magellanie à bord de leur cotre.
Cap Horn, Magellanie, Araucanie, Patagonie, Ushuaïa, ces territoires des sud chilien et argentin ont le parfum de l’aventure. Chez Coloane, l’écriture sent le mâle, le mouton, le chien, les embruns, le sang. Cap Horn est un recueil d’une quinzaine de courtes nouvelles taillées à la serpe, mettant l’Homme dans sa fragilité face à la nature et aux éléments tous puissants en cette pointe sud du continent américain. Des histoires d’hommes, écrites à la pointe de l’Eskilstuna, le couteau de ces gauchos de la Tierra del Fuego et des pêcheurs de Punta Arenas bravant la furie du cap Horn et des côtes de Magellanie à bord de leur cotre.
Le monde décrit par Francisco Coloane est essentiellement masculin – peu de femmes, souvent présentes pour leur malheur – et animal – ces hommes vivent au milieu de moutons, chiens, oiseaux, phoques, chevaux. Chaque nouvelle narre un destin tragique. La plume de Coloane, admirablement traduite par François Gaudry, réveille le bovarysme du lecteur et le téléporte au coeur de ces plaines balayées par la fureur d’Éole comme dans l’oeil des tempêtes du Cap Horn. On épouse la vie de ces êtres durs-à-cuire, habités d’une violence qui rime avec celle des éléments, le temps d’une histoire.
L’humanité crue face à la nature nue, sans fard ni fioritures. Ces nouvelles interrogent notre humanité, quand remise à sa juste place au sein de l’écosystème, celle-ci se trouve confrontée à la cruauté des hommes comme à celle d’un environnement hostile. C’est dans ces conditions extrêmes que se révèle la valeur des hommes.
Philippe Rubempré
Francisco Coloane, Cap Horn, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry, Éditions Phébus, 1994, 182 pages, prix selon bouquiniste.
Ab hinc… 198
« La Magie croit aux transformations immédiates par la vertu des formules, exactement comme le Socialisme. » – Gustave Flaubert



