Ab hinc… 169
« En démocratie, la politique est l’art de faire croire au peuple qu’il gouverne. » – Louis Latzarus
Le génie des orifices. Esthétique des plaisirs de la table et du lit – Jean-Pierre Dufreigne
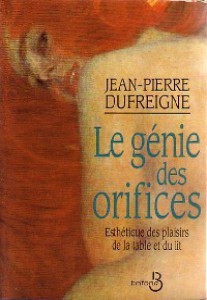 Sous-titré Esthétique des plaisirs de la table et du lit, Le génie des orifices, plus qu’un essai, est une promenade apéritive et érudite au gré des neuf types de trous que compte le corps humain. Ce livre est à déconseiller absolument aux héritiers moraux du procureur Pinard, qu’ils se classent parmi les Diaphoirus de dispensaire , les grenouilles de bénitiers et autres faces de carême (ou de ramadan, ou de hanouka, peu importe, la connerie intégriste est une des choses les mieux partagées au monde). L’auteur, Jean-Pierre Dufreigne, ne cherche pas à choquer le bourgeois, à offenser une quelconque religion (il se revendique catholique) ou à inciter à la débauche (il confesse s’être naguère abandonné « à l’adoration du flacon malté » tout en constatant que « nul soudard ne peut se comparer au consul d’Au-dessous du volcan, ni à son génial auteur, Mr Malcom Lowry »). En revanche, son petit traité promeut un savoir-vivre certain – et en voie de disparition, hélas – où l’être de culture connaît son corps et sait en jouir, sexuellement, gastronomiquement, intelligemment. Dufreigne ne craint pas de convoquer au même banquet Kant critiquant « la Raison en se torchonnant au vin et rhum (selon Michel Onfray et son Ventre des philosophes (…) », et Madonna, « un nombril qui danse » ; la Madone qui affirme en outre, citée par Denyse Beaulieu dans son Histoire culturelle de la sexualité (Sex Game Book – Histoire culturelle de la sexualité, Assouline, 2006) que « le sexe n’est sale que quand on ne se lave pas ».
Sous-titré Esthétique des plaisirs de la table et du lit, Le génie des orifices, plus qu’un essai, est une promenade apéritive et érudite au gré des neuf types de trous que compte le corps humain. Ce livre est à déconseiller absolument aux héritiers moraux du procureur Pinard, qu’ils se classent parmi les Diaphoirus de dispensaire , les grenouilles de bénitiers et autres faces de carême (ou de ramadan, ou de hanouka, peu importe, la connerie intégriste est une des choses les mieux partagées au monde). L’auteur, Jean-Pierre Dufreigne, ne cherche pas à choquer le bourgeois, à offenser une quelconque religion (il se revendique catholique) ou à inciter à la débauche (il confesse s’être naguère abandonné « à l’adoration du flacon malté » tout en constatant que « nul soudard ne peut se comparer au consul d’Au-dessous du volcan, ni à son génial auteur, Mr Malcom Lowry »). En revanche, son petit traité promeut un savoir-vivre certain – et en voie de disparition, hélas – où l’être de culture connaît son corps et sait en jouir, sexuellement, gastronomiquement, intelligemment. Dufreigne ne craint pas de convoquer au même banquet Kant critiquant « la Raison en se torchonnant au vin et rhum (selon Michel Onfray et son Ventre des philosophes (…) », et Madonna, « un nombril qui danse » ; la Madone qui affirme en outre, citée par Denyse Beaulieu dans son Histoire culturelle de la sexualité (Sex Game Book – Histoire culturelle de la sexualité, Assouline, 2006) que « le sexe n’est sale que quand on ne se lave pas ».
À l’instar de Stendhal composant ses Promenades dans Rome, Dufreigne nous offre ses promenades dans le corps humain. Une balade finement érudite, littéraire, philosophique et gourmande, visitant peau, bouche, nez, oeil, oreilles, fossette, nombril, vulve et cul. Un bonheur de lecture où Anthelme Brillat-Savarin croise le nez de Gogol, et où la Lolita de Nabokov rencontre Lucrèce… Placé sous le patronage de Guillaume Apollinaire, Le génie des orifices est une ode au corps humain et à ses plaisirs, une ode aux arts dans ce qu’ils subliment par la beauté, un bréviaire de littérature, un programme alléchant d’un cinéma comme il ne s’en fait plus.
Jean-Pierre Dufreigne n’est pas avare de bonnes formules, et notamment quand il s’agit de souligner l’hypocrisie des ligues de vertu. Ainsi de démontrer que « un ivrogne glabre est moins dégonflé qu’un barbu sobre » ou de constater que « l’antitabagisme nuit gravement à la liberté ». Et de fait, cela relève de plus en plus de la censure moralinisante (cf les expositions récentes sur Tati, Malraux ou Sartre, pour les affiches desquelles on avait fait disparaître respectivement la pipe et les cigarettes au nom d’une loi Évin au comble de sa stupidité, du ridicule et du travestissement d’une réalité historique). Amateur de cigares comme de cigarillos, je soutiens Dufreigne quand il écrit que « empêcher d’en griller une c’est asexuer Gilda. Dénigrer le tabac c’est châtrer Dom Juan en censurant (les) premières lignes du chef d’oeuvre de Molière ». Étudie-t-on encore l’acte I scène 1 du Festin de Pierre mettant en scène Sganarelle « tenant une tabatière » ? Je ne le crois pas. Il s’agit pourtant d’une pièce majeure de la littérature et du théâtre français. Je laisse à Molière (cité par Dufreigne) le mot de la fin, dans la bouche de Sganarelle :
« Quoi que puissent dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac, c’est la passion des honnêtes gens ; et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre ; non seulement il réjouit, et purge les cerveaux humains ; mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde ?«
Philippe Rubempré
Jean-Pierre Dufreigne, Le génie des orifices. Esthétique des plaisirs de la table et du lit, Belfond, 1995, 187p., prix selon bouquiniste.
Chronique à retrouver sur le Salon Littéraire.
Y a-t-il un docteur dans la salle ? – René Fallet
Voilà une chronique qui porterait sans mal un titre façon tableau, du genre « Autopsie d’un amour contemporain au scalpel des vers de Brel ». Y a-t-il un docteur dans la salle ? est un roman coloré, sensuel et tragique comme une toile de Gauguin.
Régis Ferrier, auteur et metteur en scène de 48 ans, est un grand amoureux devant l’Éternel, même s’il n’aime plus son épouse légitime… et si ses amours ne durent que rarement trois ans. Else, Mouche, Marieke… et Marthe ! Marthe, la toubib gauchiste de vingt ans sa cadette, Marthe maquée avec son hippie suisse ; Marthe au sein droit sensiblement plus proéminent que l’autre.
Avec ce roman publié en 1977, René Fallet se fait plaisir et le partage. Il ne manque pas de saisir son époque au plus juste, voire avec le sens de l’anticipation singulier qu’il démontrera dans La soupe aux choux. Ses aphorismes sont d’une pertinence inégalée aujourd’hui, jugez en vous-même : « Le gauchisme mène à tout, et surtout à la convention… ». C’est vérifié aujourd’hui, regardez où sont les anciens gauchistes. Fallet fait preuve en outre d’un sens du tragique dans la narration de l’amour qui, versification exceptée, n’est pas sans rappeler Corneille et Racine.
 Mécanique implacable de la jalousie sur fond de liberté et d’insouciance propres aux années 1970, le tout baignant dans les vapeurs de whisky et l’écume de bières belges. Marthe est jeune, rencontrée au sein de la bande de potes de Nadine, nièce de Régis, elle vit en communauté rue d’Aubervilliers, a un régulier, ancien drogué. Le choc des générations est saisi à point par Fallet, choc des conceptions amoureuses aussi. Et de mettre dans la bouche de Ferrier ces mots que lui-même n’aurait sans doute pas reniés :
Mécanique implacable de la jalousie sur fond de liberté et d’insouciance propres aux années 1970, le tout baignant dans les vapeurs de whisky et l’écume de bières belges. Marthe est jeune, rencontrée au sein de la bande de potes de Nadine, nièce de Régis, elle vit en communauté rue d’Aubervilliers, a un régulier, ancien drogué. Le choc des générations est saisi à point par Fallet, choc des conceptions amoureuses aussi. Et de mettre dans la bouche de Ferrier ces mots que lui-même n’aurait sans doute pas reniés :
« « Tu n’auras plus mes fesses si elles ne dorment pas à vie contre les tiennes. » L’amour, ce n’est pas ça pour moi. J’ai connu des gens, mariés chacun de leur côté, qui ne pouvaient se voir qu’une heure de temps en temps entre deux portes et qui, sans jamais un week-end ou un jour de vacances à eux, s’aimaient. Des années. Jusqu’au bout. Marthe n’est pas de ce sang-là. Dommage. Ce n’est pas une dame. C’est de l’ordinaire, et j’ai pourtant tout essayé pour améliorer cet ordinaire.«
Ces mots de Ferrier montrent aussi la confrontation avec le féminisme qui se retrouvent au fil des pages, pour le meilleur et souvent pour le rire.
Grandeur et décadence des amours de Régis Ferrier aux accents bréliens, les vers du grand Jacques ponctuant le cours du récit. Brel et Fallet se rejoignent dans leur art de saisir l’instant, de capter l’émotion en quelques phrases, voire quelques mots. Ils se rejoignent aussi dans l’art de chanter les amours déçues. On retrouve de L’Ivrogne et du Jeff chez Ferrier / Fallet, en plus désenchanté, peut-être…
« – Paumée ! C’est votre grande excuse ! La panacée du jour ! Quand vous faites des conneries, c’est toujours parce que vous êtes paumés ! Je me tape La Godille parce que je suis paumée ! Je me came parce que je suis paumé ! C’est trop pratique. Moi, si je bois, c’est parce que je le veux bien, au moins ! Je prends mes risques. Je n’incrimine pas la fatalité.«
Concluons notre chronique en soulignant chez Fallet un sens de la formule rappelant le grand Michel Audiard. Avant-goût avant que vous ne vous précipitiez pour vérifier s’il y a bien un docteur dans la salle : « Son cul en a vu d’autres, d’accord, mais il n’a jamais volé aussi bas, le malheureux. »
Philippe Rubempré
René Fallet, Y a-t-il un docteur dans la salle ?, Denoël, 1977, 361p., 9,50€ en poche (Folio)
Et si on aimait la France – Bernard Maris
 Ayant achevé la lecture de Et si on aimait la France, dernier essai inachevé de Bernard Maris, l’Oncle Bernard assassiné le 7 janvier 2015 lors de l’attentat islamiste contre la rédaction de Charlie Hebdo, je redécouvre une gauche intelligente, ouverte au débat, patriote et… de gauche ! Les tartuffes autoproclamés de la morale de gauche, qui n’est chez eux que moraline bien-pensante et contre-productive, m’avaient fait oublier que la gauche ne se résume pas au bal de faux-culs donneurs de leçons aux frais des autres (faites ce que je dis, pas ce que je fais, ils savent s’épargner les remèdes qu’ils prônent). Michel Onfray nous a rappelé qu’il est possible d’être de gauche et d’être en accord ponctuellement avec un Alain de Benoist, intellectuel de droite (assumée) si ce dernier a raison ; et de s’opposer à sa propre famille politique quand elle préfère introduire la théorie du genre (peu importe le nom qu’on lui donne) à l’école au nom de l’égalité au lieu d’apprendre aux gamins à lire, écrire et compter, c’est-à-dire au lieu de leur donner une réelle égalité de chances en rattrapant par le haut des lacunes familiales ou sociales. Les intellos totalitaires par complaisance préfèrent toujours quant à eux avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron… À l’instar d’autres comme Onfray, Michéa ou Julliard (chacun à sa manière), Bernard Maris réveille une espérance de gauche disparue, noyée dans le libéralisme libertaire théorisé par Terra Nova et appliqué sans vergogne, mais non sans un certain cynisme, par un PS au discours lénifiant, à la limite de la méthode Coué (l’UMP, qui s’est soudainement découverte Républicaine, ne vaut pas mieux. Il y a matière à développer sur le sujet, mais ce n’est pas l’objet de cette chronique).
Ayant achevé la lecture de Et si on aimait la France, dernier essai inachevé de Bernard Maris, l’Oncle Bernard assassiné le 7 janvier 2015 lors de l’attentat islamiste contre la rédaction de Charlie Hebdo, je redécouvre une gauche intelligente, ouverte au débat, patriote et… de gauche ! Les tartuffes autoproclamés de la morale de gauche, qui n’est chez eux que moraline bien-pensante et contre-productive, m’avaient fait oublier que la gauche ne se résume pas au bal de faux-culs donneurs de leçons aux frais des autres (faites ce que je dis, pas ce que je fais, ils savent s’épargner les remèdes qu’ils prônent). Michel Onfray nous a rappelé qu’il est possible d’être de gauche et d’être en accord ponctuellement avec un Alain de Benoist, intellectuel de droite (assumée) si ce dernier a raison ; et de s’opposer à sa propre famille politique quand elle préfère introduire la théorie du genre (peu importe le nom qu’on lui donne) à l’école au nom de l’égalité au lieu d’apprendre aux gamins à lire, écrire et compter, c’est-à-dire au lieu de leur donner une réelle égalité de chances en rattrapant par le haut des lacunes familiales ou sociales. Les intellos totalitaires par complaisance préfèrent toujours quant à eux avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron… À l’instar d’autres comme Onfray, Michéa ou Julliard (chacun à sa manière), Bernard Maris réveille une espérance de gauche disparue, noyée dans le libéralisme libertaire théorisé par Terra Nova et appliqué sans vergogne, mais non sans un certain cynisme, par un PS au discours lénifiant, à la limite de la méthode Coué (l’UMP, qui s’est soudainement découverte Républicaine, ne vaut pas mieux. Il y a matière à développer sur le sujet, mais ce n’est pas l’objet de cette chronique).
Ceci étant posé, revenons aux quelques cent quarante pages de la déclaration d’amour de Bernard Maris à la France. Pas une bluette niaise de midinette en fleur lectrice de Podium, non. Au fil du texte, l’auteur nous enchante par sa connaissance de la France, de son histoire comme de ses terroirs, de son peuple dans sa diversité. Et ne manque pas de rendre un hommage vibrant à son instituteur très sévère, Monsieur Vergniaud. Oncle Bernard n’est pas pour autant complaisant avec sa patrie. S’il regrette certaines orientations politiques ou économiques, s’il rappelle certains faits historiques peu glorieux (sans excuses ni repentance), il n’est pourtant jamais aussi brillant que quand il manifeste son enthousiasme pour notre langue, notre histoire, notre culture. En outre, il ne donne pas dans le sectarisme ou l’inquisition sauce Plenel ou Dély (liste non-exhaustive, trop longue à établir). Il n’hésite pas à se référer à des auteurs de droite, voire plus, et horresco referens, à leur reconnaitre qualités et talent. Bref, il admet qu’on puisse ne pas penser comme lui sans être réduit à l’état de salaud ou de fasciste (une exception, hélas, à gauche aujourd’hui). Son duel de papier avec Zemmour, qu’il a lu et qu’il commente dans son essai, se règle au fleuret des arguments ; pas dans la médiocrité de l’insulte ou la vaine condamnation morale – dont pourtant Charlie Hebdo use quelquefois (dans des proportions moindres il est vrai que Libération, L’Obs ou certains ténors du PS).
De la France, Bernard Maris nous dit qu’il faut l’aimer. Son amour de la France transpire au fil des pages. Aimons sa langue, sa littérature, son histoire, sa géographie, l’extraordinaire diversité des paysages, de la faune et de la flore, aimons sa grandeur, j’allais dire sa majesté… Tout ce que depuis la loi Haby nos dirigeants de droite comme de gauche s’échinent à exclure de l’école pour faire de nos enfants des consommateurs idiots et soumis, et/ou des coquilles de mollusques vides tolérant tout sauf le talent, l’excellence et le goût. Bernard Maris à la France à l’estomac ; il aurait pu reprendre à son compte l’invitation lancée par Ernest Lavisse dans son manuel d’Histoire à « aimer la France parce que la nature l’a faite belle, et son histoire l’a faite grande ».
Écrit dans un style à la fois fluide et classique, Et si on aimait la France se déguste comme un grand bourgogne. Avec cet essai inachevé, Bernard Maris démontre, s’il en était besoin, que la France est un grand et beau pays, qui mérite mieux que sa dissolution dans le mondialisme fade des financiers incultes et déracinés. Il fait aussi honneur à la gauche française en lui redonnant une tenue et une expression littéraire, politique, argumentée et cultivée qu’elle a – et je le regrette – trop souvent tendance à oublier pour verser dans la facile condamnation moralinisante ou le procès d’intention sauce trotskyste revisitée.
Quand bien même nous ne partageons pas ses idées, Bernard Maris nous offre avec la manière de réfléchir sur la France, son identité et son destin. Un essai revigorant en ces temps déprimés et égoïstes, une invite à la discussion et à la dispute civilisée (l’expression, que je trouve excellente, est empruntée à Elisabeth Lévy), doublée d’un bel hommage à la France.
Philippe Rubempré
Bernard Maris, Et si on aimait la France, Grasset, 2015, 142 pages, 15 euros




