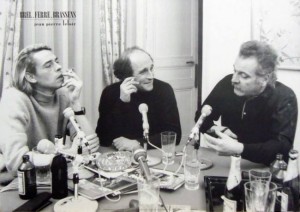Ab hinc… 191
« Les livres sont des maîtres qui nous instruisent sans verges ni férules, sans cris ni colères. Si on les approche, on ne les trouve point endormis, si on les interroge, ils ne dissimulent point leurs idées. Si l’on se trompe, ils ne murmurent pas… O livres, qui possédez seuls la liberté, qui seuls en faites jouir les autres et qui affranchissez tous ceux qui vous ont voué un culte fidèle ! » – Richard de Bury
Brassens, une mauvaise réputation – ouvrage collectif
 Brassens, une mauvaise réputation est un album hybride riche de photos rares, réunissant entretiens avec le poète moustachu et textes relatifs à sa vie et son oeuvre. La préface signée Bernard Lavilliers, qu’on a connu en meilleure forme, s’avère décevante et apporte peu si ce n’est rien à cette composition quelque peu anarchique.
Brassens, une mauvaise réputation est un album hybride riche de photos rares, réunissant entretiens avec le poète moustachu et textes relatifs à sa vie et son oeuvre. La préface signée Bernard Lavilliers, qu’on a connu en meilleure forme, s’avère décevante et apporte peu si ce n’est rien à cette composition quelque peu anarchique.
Les éditions Consart proposent toutefois un bel objet articulé autour de trois textes essentiels. L’analyse du Brassens libertaire par Marc Wimet, passionnante, plonge au coeur des mots du chroniqueur anar comme de ceux de l’anar chanteur. La retranscription de l’entretien de Michel Polac avec Brassens et René Fallet pour l’émission Le Livre de Poche s’intéresse au Brassens lecteur, Gargantua de la descente d’imprimé. La discussion menée de main de maître par un artiste du genre se révèle surprenante et nous en sortons avec plein d’idées de lectures à venir. À noter le passage sur cette merveille signée Claude Tillier, Mon Oncle Benjamin, oeuvre chroniquée sur le Salon Littéraire par votre serviteur. Enfin, un entretien intéressant conduit par Gilbert Bovay sur Brassens et son monde vu par Brassens.
Autour de ces trois morceaux d’anthologie, le journaliste musical Olivier Horner propose quelques pastilles thématiques bienvenues, offrant un regard neuf sur la vie et l’oeuvre de Brassens, sa relation avec la gent féminine, la censure dont il fut l’objet plus que n’importe quel autre chanteur de son temps, et la rencontre fameuse Brassens – Brel – Ferré.
Avec cette composition foutraque à l’iconographie particulièrement soignée et singulière, les éditions Consart réussissent un portrait original du chanteur moustachu, amoureux de la liberté, de la poésie, des chats et de Püppchen. Une discographie sélective et critique conclut ce livre que les brassensophiles apprécieront à sa juste valeur.
Philippe Rubempré
Gilbert Bovay, Olivier Horner, Michel Polac & Marc Wilmet, Brassens, une mauvaise réputation, Éditions Consart, 2011, 100 pages, 25 euros
Chronique à retrouver sur Le Salon Littéraire.
L’île au trésor – Pierre Pelot
 Hommage du prolifique et éclectique Pierre Pelot au maître écossais du roman d’aventures Robert-Louis Stevenson. Nous retrouvons le jeune Jim Hawkins sur une île touristique au large du Brésil, chasseur à ses heures perdues pour le Barrocco, hôtel tenu par sa tante Sally-Sea et le compagnon de celle-ci, Trelaway. À la différence du roman de Stevenson, celui de Pelot est situé au XXIème Siècle, après un accident climatique, cette montée du niveau des eaux qu’on attendait ni si tôt, ni si rapide, et qui a remodelé la surface du globe d’une manière surprenante et encore imparfaitement connue.
Hommage du prolifique et éclectique Pierre Pelot au maître écossais du roman d’aventures Robert-Louis Stevenson. Nous retrouvons le jeune Jim Hawkins sur une île touristique au large du Brésil, chasseur à ses heures perdues pour le Barrocco, hôtel tenu par sa tante Sally-Sea et le compagnon de celle-ci, Trelaway. À la différence du roman de Stevenson, celui de Pelot est situé au XXIème Siècle, après un accident climatique, cette montée du niveau des eaux qu’on attendait ni si tôt, ni si rapide, et qui a remodelé la surface du globe d’une manière surprenante et encore imparfaitement connue.
C’est dans ce contexte qu’un soir de tempête tropicale le capitaine Billy Bones débarque et s’écroule littéralement dans le hall d’entrée du Barrocco. Jim se lie d’affection avec cet étrange énergumène qui ne sort de sa chambre quasiment que pour se payer des muflées phénoménales ! L’air perpétuellement préoccupé, Billy Bones semble redouter quelque chose… ou quelqu’un, ce que confirme la visite d’un hurluberlu louche d’aspect. Comme chez Stevenson, Bones, lieutenant du terrible capitaine Flint, détient une carte – ici, quelques documents oubliés sur un antique téléphone portable – indiquant le lieu où est planqué le butin du pirate. Sauf que la topographie a changé entretemps. Jim, sa tante et Trelaway embarquent à bord de l’Hispaniola, commandée par un certain Silver, en quête de l’île où est enterré le fameux trésor…
En reprenant la trame de L’île au trésor et en situant l’action dans un monde post-climatique, Pierre Pelot relève la gageure et réussit à redonner un coup de fouet à cette histoire qui a bercé la jeunesse de tant de générations. L’auteur a su conserver quelques repères stevensoniens, ainsi les personnages de Jim Hawkins ou de Silver, ou le bateau Hispaniola, sans commettre pour autant un simple copié-collé futuriste du roman originel. Au petit jeu de l’hommage, Pierre Pelot se montre grand, et offre de nouvelles lettres de noblesse au roman d’aventures, trop souvent relégué à un simple divertissement pour jeunes garçons. Car sans être le moins du monde pédant, moraliste, climato-catastrophiste ou donneur de leçon, Pierre Pelot donne à réfléchir sur nos mode de vie et nos habitus de consommation en imaginant la vie dans des pays ayant subi une montée brutale du niveau des eaux, celle qu’on nous promet à terme et que ni la COP 21 ni les suivantes n’empêcheront en rien.
Avec Pierre Pelot, L’île au trésor s’offre une cure de jouvence, le roman d’aventures une crédibilité littéraire et une reconnaissance comme miroir subtil et pertinent de notre bas-monde. De l’auteur, nous avons lu également La guerre olympique, roman de science-fiction imaginant un monde où la guerre et la violence sont codifiées comme une manifestation sportive internationale, proposant une réflexion iconoclaste sur les relations humaines et sociales. Ces deux romans dénotent la personnalité forte et inclassable du romancier Pierre Pelot, un écrivain dont nous allons poursuivre l’exploration de l’oeuvre.
Philippe Rubempré
Pierre Pelot, L’île au trésor, Calmann-Lévy, 2008, 285 pages, 18 euros
Ab hinc… 190
« Pour comprendre et aimer le progrès, pour pratiquer le régime de discussion, il fallait des hommes affranchis des préoccupations vulgaires de la vie, inaccessibles aux considérations mesquines comme aux influences que subissent les ignorants et les besogneux. On ne vote selon des principes que si l’on est indépendant. » – Jacques Bainville, Histoire de France, Ch. 19- La Monarchie de Juillet
Le Grand Sud – A.D.G.
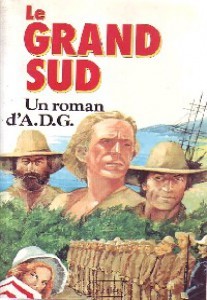 A.D.G. (pour Alain Dreux Gallou, pseudonyme d’Alain Fournier) fut à l’instar de Frédéric H. Fajardie un des grands auteurs du roman noir des années 1970. Et comme Fajardie avec Les Foulards rouges et Le Voleur de vent, il s’est essayé avec brio au roman d’aventures historique avec Le Grand Sud, fresque épique retraçant le parcours d’une poignée de forçats déportés au bagne de l’île de Nou, face à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Tous les ingrédients du bovarysme sont là : l’histoire de la Nouvelle-Calédonie française et du bagne, l’exotisme, l’aventure, l’amour, l’amitié, l’érotisme. Chacun des personnages de ce roman choral est campé avec justesse et crédibilité. Le cocktail final en est à la fois équilibré et détonant !
A.D.G. (pour Alain Dreux Gallou, pseudonyme d’Alain Fournier) fut à l’instar de Frédéric H. Fajardie un des grands auteurs du roman noir des années 1970. Et comme Fajardie avec Les Foulards rouges et Le Voleur de vent, il s’est essayé avec brio au roman d’aventures historique avec Le Grand Sud, fresque épique retraçant le parcours d’une poignée de forçats déportés au bagne de l’île de Nou, face à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Tous les ingrédients du bovarysme sont là : l’histoire de la Nouvelle-Calédonie française et du bagne, l’exotisme, l’aventure, l’amour, l’amitié, l’érotisme. Chacun des personnages de ce roman choral est campé avec justesse et crédibilité. Le cocktail final en est à la fois équilibré et détonant !
Quand Lobeau, vrai-faux dandy russe et véritable faux-monnayeur, Lizidore, jeune paysan tourangeau et braconnier, et Le Clairon, militaire pour le moins indiscipliné, débarquent après six mois de mer sur l’île de Nou, ils font connaissance avec les réjouissances du bagne et ses usages, de la hiérarchie établie au sein même de la chiourme aux punitions, du classique fouet à la crapaudine délicatement tortionnaire… Leur rivalité avec les forçats Massé et Buisson-la-Teigne, l’acharnement du gardien-chef Mattéi, la soif de liberté les poussent à tenter une évasion rocambolesque vers l’Australie, risquant les cannibales, les typhons, le naufrage… Voilà le début de l’aventure de ces antihéros magnifiques que nous suivons sur une quinzaine d’années.
Premier roman d’aventures signé A.D.G., Le Grand Sud en est, aussi et hélas, le dernier. Ce roman en appelle pourtant d’autres, ce que la vie et la maladie ne rendront pas possible. A.D.G. se joue avec délices des niveaux de langages, jonglant habilement avec le sabir administratif et l’argot des fortif’, sautant allègrement du jargon militaire au discours vindicatif et militant des communards déportés. Tout le roman est porté par le flot de l’Histoire et les vagues des histoires, retraçant quinze ans de la grande et de la petite histoire de la présence française en Nouvelle-Calédonie.
Philippe Rubempré
A.D.G., Le Grand Sud, J.C. Lattès, 1987, 545 pages, prix selon bouquiniste.
Article à retrouver sur le Salon Littéraire.