Ab hinc… 187
« Je bois… Je bois… C’est vite dit. Qu’est-ce que je bois ? Que des choses saines, que des trucs naturels ! Que du vin ! Que du beaujolpif qu’il y a pas meilleur au corps, tous les toubibs te le diront ! Cinq, six bouteilles par jour, jamais plus. Du fortifiant. Des vitamines comme s’il en pleuvait ! » – René Fallet, Le Beaujolais nouveau est arrivé.
Les Raisons de ma colère – Alain Griotteray
« La France était paisible et prospère. Elle est devenue un pays violent et à la traîne. Et de nombreux signes indiquent que le déclin va s’accélérer.«
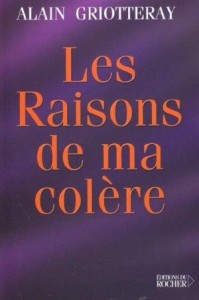 Cette constatation est formulée par Alain Griotteray au crépuscule des années Jospin, exactement entre le 11-Septembre 2001 et le « choc » du 21 avril 2002, qui a vu l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle au détriment du candidat socialiste, le Premier ministre sortant Lionel Jospin. Force est de constater qu’il n’avait pas tort…
Cette constatation est formulée par Alain Griotteray au crépuscule des années Jospin, exactement entre le 11-Septembre 2001 et le « choc » du 21 avril 2002, qui a vu l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle au détriment du candidat socialiste, le Premier ministre sortant Lionel Jospin. Force est de constater qu’il n’avait pas tort…
Alain Griotteray, résistant de la première heure qui chantait la Marseillaise sur la tombe du Soldat inconnu le 11 novembre 1940 à l’heure où le Parti Communiste Français invitait les ouvriers à collaborer avec les soldats allemands conformément au Pacte Germano-Soviétique, fut maire de Charenton-le-Pont, co-fondateur de l’UDF (Union pour la Démocratie Française, dont il démissionna en 1998), journaliste (au Figaro Magazine notamment) et « patron » d’un libre journal sur Radio Courtoisie. Il est décédé en août 2008.
Les Raisons de ma colère est un court essai, à la lisière du pamphlet, commandé par l’éditeur Jean-Paul Bertrand qui avait déjà publié quatre « colères » aux éditions du Rocher. Griotteray est un homme de droite, qui s’assume comme tel, et qui n’est pas tendre avec la maladresse et la lâcheté de son propre camp. Sa colère est suscitée par le déclin de la France libre, fière et indépendante. Les raisons en sont diverses, mais constituent in fine un corpus homogène. La haine de la France et de son histoire forcément coupable est servie par l’anti-patriotisme de ses élites politiques qui n’hésitent pas à prostituer la France au mondialisme à travers l’Europe ultra-libérale, technocratique et anti-démocratique : « (…) leur économie, leur justice, leur politique étrangère, leur politique militaire, en un temps où on les abreuve de discours sur la décentralisation nécessaire, sont transférées à une autorité extérieure et que leur Assemblée nationale ou leur Sénat deviennent peu à peu des sortes de conseils généraux. Un jour (…), d’aucuns diront « nous n’avons pas voulu cela ! » Cela ? C’est-à-dire la fin de la démocratie, telle que l’Occident européen l’a conçue (…). Car est-ce autre chose que la naissance d’une sorte de régime autocratique à laquelle nous assistons sans vouloir l’admettre ? » Qui pourra nier la lucidité d’Alain Griotteray après le camouflet anti-démocratique du Traité de Lisbonne adoptant le projet de constitution européenne rebaptisé traité après son rejet démocratique par voie référendaire ? Qui pourra nier cette réalité à la lumière d’une Union européenne imposant par le haut l’ultra-libéralisme financier contre les intérêts démocratiques des peuples ? qui impose une politique d’immigration contraire à la volonté des peuples ? qui développe une politique étrangère contraire aux intérêts des peuples européens ? « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » dixit le président de la Commission Juncker. Voilà la démocratie européenne, le moindre désaccord vous renvoie des les arcanes sulfureuses des dictatures, du fascisme ou de je ne sais quoi encore. Même chose en économie où l’Union européenne garantit envers et contre tout le there is no alternative tatchérien, très démocratique lui aussi.
Le corpus se complète de l’ignorance volontaire, lâche et/ou intéressée des élites politiques françaises au pouvoir en ce qui concerne la réalité de la violence ou la question de l’islam, entre autres. Pour ce qui concerne la violence, La France Orange Mécanique, de Laurent Obertone démontre, malgré ses imperfections, que la situation n’a pas évolué favorablement, mais que le vocabulaire s’est adouci (par exemple, on parle d' »incivilités » au lieu de « délits ») dans une euphémisation volontaire « pour ne pas stigmatiser »… Pourquoi, il y aurait des raisons de le faire ? Un voyou est un voyou, et c’est marre. Personne n’est voyou a priori. Mais refuser de qualifier les voyous, c’est se priver des moyens de comprendre la délinquence ou le crime, et donc de répondre de manière appropriée et juste.
Quant à la question de l’islam et de sa présence en France, la poser est déjà une preuve de racisme (bien qu’il n’existe pas de race musulmane) ou d’islamophobie (ce terme mis à la mode par l’ayatollah Khomeiny pour condamner toute critique de l’islam, bien qu’étymologiquement il ne signifie que la peur de l’islam, aucunement la haine, ainsi que le rappelait Olivier Rolin dans une tribune du Monde). Une certaine gauche est incapable de différencier la question de l’islam et celle des musulmans, qui si elles sont intrinsèquement liées, ne se confondent pas pour autant. Nous pouvons demander légitimement aux musulmans vivant en France de privilégier d’une manière sine qua non la loi et le modus vivendi français sur leur foi et leur pratique religieuse, tout comme nous l’avons demandé aux Juifs et aux protestants (qui ont tout de suite vue l’opportunité que cela constituait pour eux) et imposé aux catholiques non sans heurts… En revanche, il parait difficile de « réformer » le Coran, texte directement transmis par Allah à son prophète, par conséquent bloc inviolable pour nombre de croyants.
Ainsi, Griotteray note en 2002 que « notre « inintelligentsia » actuelle, qui refuse de regarder les conflits, de lire le Coran, et de comprendre que pour la majorité des musulmans il est la parole même de Dieu, qu’on n’y peut rien retrancher, est coupable. » La situation dans le monde musulman s’est largement dégradée depuis que Griotteray a écrit ces lignes (en grande partie à cause de l’inconséquence des politiques occidentales menées au nom des droits de l’homme), et le terrorisme a refait son apparition en France. Doit-on rappeler que 2015 s’est ouverte avec les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher de Vincennes, et que cette année restera de sinistre mémoire comme celle qui a vu la première décapitation islamique en métropole… La réponse à cette réalité n’est certainement pas pas la haine du musulman ou sa « stigmatisation » mais ce n’est pas non plus la ritournelle viciée du padamalgam, rappelant sans cesse et sans vergogne pour les victimes réelles que ce sont les musulmans les premières victimes. Vrai en terre d’islam, faux et archi-faux pour la France. Par ailleurs, les condamnations de l’antisémitisme, des attentats de Charlie Hebdo… sont bien faibles et relativement inaudibles au sein du groupe social musulman, quand elles ne sont pas assorties d’un mais qui n’a pas lieu d’être. Les citoyens français sont tous égaux en dignité, en droits et en devoirs, les musulmans comme les autres, la République ne distingue pas. Elle devrait pourtant se garder d’ignorer, car ignorer revient à se priver des moyens de comprendre et de réagir, donc à apporter de mauvaises réponses qui ne peuvent accoucher que de la méfiance, de la haine, de la désintégration de la Nation. Au détriment des plus faibles.
La réponse ne peut venir que d’élites disposant d’une culture historique non-idéologisée, d’une culture géographique, économique… c’est-à-dire d’une élite politique qui n’existe plus depuis la mort de Pompidou. Mais seule cette élite-là est à même de constater objectivement ce qui est et de nommer les choses telles qu’elles sont (je ne cite pas à nouveau Péguy et Camus, ils le sont beaucoup en ce moment). Cette élite ne peut se déployer démocratiquement que dans le cadre d’un État-Nation, politiquement libéral et économiquement libre, respectueux de l’humain et de l’intérêt général. Ce n’est plus le cas de la France de 2015 fissurée de l’intérieur, économiquement faible et soumise aux injonctions ultra-libérales de Bruxelles, contraires à son histoire et à ses intérêts économiques (mais favorables aux géants agricoles de l’Europe du Nord et à l’industrie allemande), et ridiculement alignée en politique étrangère, tantôt sur les États-Unis, tantôt sur le Qatar et l’Arabie saoudite… Les terroirs qui font la richesse de l’agriculture, de la gastronomie et du tourisme sont abandonnés, comme le patrimoine qui rappelle nos heures glorieuses. La langue et l’histoire sont les premières sacrifiées de l’éducation. Voilà le tableau peu reluisant de la France une petite quinzaine d’années après la parution de l’essai d’Alain Griotteray. Il a hélas vu juste, peut-être même était-il optimiste. Seul l’effondrement des retraites n’a pas (encore) eu lieu, mais ne désespérons pas de nos élites politiciennes…
Pessimiste, défaitiste, décliniste, j’attends les réactions suite à ma chronique. Je ne suis pas optimiste, les indicateurs ne me le permettent pas. Mais rien est perdu. La solution, Pasqua – qui avait de nombreux défaut, mais qui est trop souvent et trop facilement réduit à sa caricature – l’a donnée dans une réponse à Romano Prodi, cité par Griotteray : « (…) la seule méthode (…) est de redonner la parole aux peuples d’Europe (…). Les peuples (…) ont toujours raison, même si les élites pensent qu’ils se trompent. » Je suis plus réservé sur la seconde partie de la solution, mais la démocratie, c’est-à-dire le peuple souverain, reste le pire des régimes à l’exception de tous les autres. Alain Griotteray, après avoir constaté l’aveuglement des élites actuelles sur la question de l’islam (cité plus haut) – mais qui peut s’appliquer à beaucoup d’autres domaines – dénonce cette lâcheté en ces termes, qui seront notre conclusion : « D’autres ne lurent pas Mein Kampf et espéraient calmer la bête immonde en lui laissant l’Autriche ou les Sudètes. Comme à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les pacifistes, lâches ou naïfs, désarment moralement leur camp pour mieux le faire perdre.«
Philippe Rubempré
Alain Griotteray, Les Raisons de ma colère, Éditions du Rocher, février 2002, 108 pages, 11 euros
Ab hinc… 186
« Quoi de plus arbitraire que d’exclure les femmes ? On dit que c’est injuste… Ce n’est pas injuste, c’est idiot ! » – Charles Maurras, cité in Jacques de Guillebon, La République nous interpelle, Causeur N°29, novembre 2015, p. 94.
Ab hinc… 185
« La France est peut-être le seul pays au monde où l’on cherche plus à réagir contre les idées dont on se choque, que contre les abus dont on souffre. » – Antonin François Rondelet, Réflexions de littérature, de philosophie, de morale et de religion.





